2021 : 25 janvier : Lectures croisées : Autour de l'Empire Inca, du colonialisme, du "décolonialisme"... (Première partie)
Adolescent déjà, je détestais l’eurocentrisme. La critique de l’eurocentrisme, préalable à une critique du colonialisme, dans le cas de la France s’exprime au moins depuis Montaigne, puis Montesquieu, pour aboutir à Lévi Strauss notamment. Ce n’est pas une prise de conscience tardive, elle se développe en même temps que les pays européens se taillent des empires outremer.
Anibal Quijano, sociologue péruvien parfois considéré comme fondateur de la pensée « décoloniale » n’a donc pas inventé grand-chose, sauf peut-être la réduction abusive de la « modernité » à la « colonialité », une idée peut être nuancée dans son esprit mais qui est dévoyée en une vulgate à l’usage de crétins universitaires et un slogan creux à l’usage de militants qui ne font que reproduire les pires des comportements des gardes-rouges de la « révolution culturelle » chinoise et, par exemple, sous prétexte de « décoloniser » la science, proposent sont rejet complet, car la science serait « occidentale et raciste », et son remplacement par la sorcellerie africaine, comme on a pu le voir lors d’un débat dans une université sud-africaine il y a quelques années. Les mots « décoloniser » ou « décolonial » sonnent bien et donnent bonne conscience à quiconque s’en empare, se croyant dès lors autorisé à proférer n’importe quelle ânerie, tout comme le mot « liberté » qui autorisait tant de crimes, ou bien « prolétariat » et avant lui les mots « vraie religion ». (À ce sujet, voir en lien ci-dessous l’article que j’ai récemment traduit)
Formulée d'abord en Amérique latine par Walter Mignolo (professeur argentin dans une université aux USA) et par d'autres sur d'autres continents, la théorie "décoloniale" a essaimé dans le monde entier, évoluant en un salmigondis essentialiste et antimoderne souvent nauséabond, et passant du discours universitaire à celui de certains mouvements politiques comme le PIR en France, sans aucune garantie de bonne compréhension ni d'honnêteté intellectuelle, comme le veut en général ce mélange des genres.
http://dixansderetard.canalblog.com
C’est là que la « gauche » dite postmoderne finit par rencontrer le fascisme des phalangistes espagnols qui criaient « à bas l’intelligence », car ils réclamaient un retour, non pas à la sorcellerie africaine mais à la théocratie catholique castillane. Pour qui a deux sous de jugeotte, ces convergences entre « décoloniaux », « maoïstes » et « phalangistes » n’ont rien de surprenant, elles résultent d’une vision sectaire et simplificatrice qui amalgame « modernité », « colonialisme » et « européen » en un magma aussi indistinct que haïssable, et ignore délibérément la multiplicité des courants de pensée européens, leurs divergences, leurs oppositions, leurs sources extra-européennes, pour se résumer en : « tout ce qui est européen est colonial, tout ce qui est moderne est européen, tout ce qui est moderne est colonial » donc la modernité est haïssable en bloc. Derrière ce rideau de fumée ce cachent des projets politiques identitaires, théocratiques et sectaires qui reviennent de loin dans le passé. Attaquer la laïcité, l’humanisme et l’universalisme en les disant « européens » et donc « coloniaux » ou « racistes » est une parfaite malhonnêteté, c’est feindre d’ignorer par exemple le poète Al Maari, ou le romancier Naguib Mahfouz, et tant d’autres…
C’est beaucoup d’honneur et beaucoup d’indignité pour les quelques pays qui se partagent l’Europe, cette petite péninsule à l’extrémité occidentale du continent asiatique, ce cul-de-sac de l’Ancien Monde où sont venus échouer tant de vagues d’envahisseurs déferlant de l’est. Quelques pays auxquels la roue de l’Histoire à offert à tour de rôle leur quart de millénaire de célébrité, mais qui ont de plus en plus de mal à se maintenir à flot.
Chose étrange, les « décoloniaux » postmodernes qui font rage actuellement, et prétendent lutter contre l’eurocentrisme, sont obnubilés par l’Europe et en font le centre de leurs préoccupations et de leur vision du monde. Pour eux l’histoire de l’humanité commence en 1492, dont ils font l’an 1 de l’impérialisme, et les gloires mortifères des autres continents les laissent indifférents. La complexité du fonctionnement des empires depuis plusieurs millénaires sur tous les continents, le florilège des techniques de massacres que l’ingéniosité humaine a développées avec les moyens techniques de chaque époque ne touche pas leur sensibilité. C’est bien dommage.
Mais je digresse, je digresse, alors que je souhaitais cantonner mon propos au Pérou, patrie d’Anibal Quijano, un pays qui me fascine par de nombreux aspects de son histoire et sa culture, alors que je le connais trop peu, n’y ayant fait qu’un bref séjour dans mon adolescence. En ce temps là donc, je détestais déjà l’eurocentrisme. C’est un point que j’ai en commun avec les « décoloniaux », mais je ne dois rien à Anibal Quijano. C’est plutôt à la chance qui m’a été donnée de grandir sur trois continents différents, de m’émerveiller au contact de nombreuses cultures, d’apprendre des langues, et de grandir dans un climat intellectuel familial marqué par l’influence de Lévi Strauss, même si je ne l’ai lu que tardivement, pour constater combien il était d’accord avec moi.
J’ai un autre point d’accord avec Anibal Quijano, c’est l’idée selon laquelle tout état est colonial. Mais sur ce point les européens n’ont rien inventé, c’est un fait universel et très ancien. N’ayant pas lu Quijano je ne lui jetterai pas la pierre : ce n’est pas forcément sa faute s’il est mal lu ou délibérément dévoyé, (comme Frantz Fanon revendiqué par le PIR malgré ses positions contre l’antisémitisme), par des opportunistes sectaires. Bref, les états antiques ou médiévaux étaient déjà coloniaux, ce n’est pas une invention moderne, et confondre « modernité » avec « colonialité » est parfaitement malhonnête. Ce qui n’excuse en rien les crimes coloniaux des Européens. Ni ceux des autres.
Voilà un long préambule que je n’avais pas prévu, il surgit de quelques lectures de ces dernières semaines.
J’ai étudié l’histoire de l’Amérique latine quand j’étais lycéen en Equateur, puis à l’Université à Montpellier, et la cerise sur le gâteau était un grand classique publié en 1971, « La vision des vaincus » de Nathan Wachtel, qui trônait dans ma bibliothèque depuis 1990. Fin 2020, il était temps de me mettre à jour ! Cet historien français et spécialiste du Pérou est lui aussi un pionnier d’une approche non-eurocentrique et post-coloniale. (Si le livre est publié en 71, c’est un travail des années 60.)
Les images que l’on peut avoir sur ce sujet oscillent entre légende dorée (vision du vainqueur, évangélisateur, civilisateur) et légende noire de la colonisation espagnole (l’anéantissement d’un empire inca égalitaire et utopique, comme dans la chanson de Mercedes Sosa). Wachtel s’en tient à une démarche scientifique sérieuse pour étudier ses effets sur les sociétés indigènes, leur organisation, leur économie, leur culture, et confirme que la réalité ressemble fort à la légende noire. S’il se réfère pour comparaison à la conquête du Mexique par Cortéz, l’essentiel du travail porte sur celle du Pérou par Pizarro et ses soudards. La comparaison est d’autant plus pertinente que, au Pérou, Pizarro la brute analphabète n’a fait qu’imiter l’action menée par Cortés, son lointain cousin plus éduqué, une douzaine d’années plus tôt au Mexique.
Le livre de Nathan Wachtel pèse près de 400 pages, annexes comprises, autant dire que c’est une mine d’informations qu’on ne peut épuiser dans un article de blog ! La première partie étudie les traditions orales ou théâtrales et dansées par lesquelles, tant au Mexique qu’au Pérou, les descendants des Aztèques ou des Incas racontent de façon épique et mythique le cataclysme cosmique que fut pour eux l’irruption des Espagnols au début des années 1530.
Dans la seconde partie ce sont les structures de l’Etat Inca avant l’invasion qui sont étudiées : politique, économie, société, depuis les origines. Il est important de savoir que l’empire Inca est tardif, et qu’il hérite de plusieurs cultures antérieures. À leur tour les Espagnols, très peu nombreux au début, quand ils s’empareront de la tête de l’empire, feront tout pour détourner à leur profit le fonctionnement de ses institutions, quitte à les dénaturer avec le soutien d’une partie de l’aristocratie inca, dans un contexte de guerres civiles et de nombreux renversements d’alliances. Parallèlement un petit royaume Inca indépendant persiste dans la région de Vilcabamba et résiste encore quelques années.
Cette aristocratie Inca, hispanisée et christianisée, va être très tôt une source d’informations historiques écrites en recueillant ce qui jusqu’alors relevait de la tradition orale. Les plus connus sont Guamàn Poma de Ayala et Inca Garcilaso de la Vega. En recoupant leurs textes et ceux des chroniqueurs espagnols on peut reconstituer le tableau de l’effondrement Inca.
Un des facteurs principaux de l’effondrement des empires précolombiens est le choc épidémique. Si au dix-neuvième siècle en Amérique du Nord on a sciemment distribué des couvertures infectées par la variole aux indiens (l’intention génocidaire est alors indéniable) le premier choc à la fin du XV° et au début du XVI° est involontaire. Les Espagnols dans leur ignorance médiévale ne peuvent pas prévoir que les grippes, varioles et rougeoles semées dès le premier voyage de Colomb vont ravager les Amériques beaucoup plus vite qu’eux, en précédant leurs avancées de plusieurs années. (Il semble que la variole ait précédé Pizarro de cinq ans au Pérou). Réciproquement les marins de Colomb vont ramener la syphilis qui fera des ravages au siège de Naples dès 1494, et dans toute l’Europe jusqu’au XX° siècle, et fort justement personne n’accuse les femmes indigènes des Antilles de génocide. (Pas plus qu’on n’accuse l’Empire Mongol de génocide contre les Européens après la Peste noire de 1347, qui commence pourtant au siège de Caffa avec le catapultage délibéré de cadavres sur la ville. Les Mongols dans leur ignorance médiévale ne pouvaient pas savoir que 30 à 50% des Européens allaient en mourir en 5 ans. Si on voulait jouer dans la surenchère victimaire et « décoloniale » jusqu’à l’absurde, pourquoi l’Europe ne demanderait-elle pas des excuses et des réparations à la Mongolie ?). Dans le cas du Pérou Nathan Wachtel, rappelant qu’on ne dispose pas de données complètes, estime la perte de population de 1530 à 1560, entre 25 et 75% selon les régions, en moyenne 60 à 65% !
Les guerres sont bien entendu une autre cause de l’effondrement. Les Espagnols, très inférieurs en nombre, même s’ils passent brièvement pour des êtres surnaturels, sont vite reconnus comme mortels, et leur armement supérieur ne suffit pas à compenser leur petit nombre. C’est donc en tirant parti des tensions et des guerres civiles au sein des empires précolombiens qu’ils s’imposent, tant au Mexique qu’au Pérou. Là encore, ils n’innovent en rien : presque tous les empires se sont construits de cette manière. La liste en serait longue. (Depuis Jules César en Gaule, ou bien Tarik ibn Ziyad qui traverse le détroit avec l’aide du gouverneur byzantin de Ceuta, sous prétexte d’aller prêter main forte à certains clans wisigoths et juifs qui l’ont appelé à l’aide, jusqu’aux Français en Afrique au dix-neuvième siècle qui se présentent en libérateurs…) Dans le cas du Pérou c’est une guerre de succession entre Incas qui va être la chance inespérée de Pizarro. Leur père étant mort peut-être de l’épidémie de variole, les frères ennemis Huascar et Atahualpa s’affrontent déjà quand les Espagnols arrivent. Atahualpa capture et fait assassiner Huascar avant d’être lui-même capturé et assassiné par Pizarro (malgré le paiement d’une énorme rançon en or). La nature impérialiste et colonialiste de l’état Inca se retourne contre lui : il y a toujours des vassaux mécontents pour se rallier aux nouveaux maîtres. Les Espagnols mettent en place un nouvel Inca pour qu’il fasse fonctionner l’empire à leur profit. Mais rapidement, ils se divisent à leur tour entre « pizarristes » et « almagristes », entrainant les différentes fractions indigènes dans plusieurs années d’une impitoyable guerre civile « au carré », assortie de nombreuses trahisons. Certains espagnols, pourchassés par d’autres espagnols, en viennent à chercher refuge chez les Incas indépendants de Vilcabamba.
Ces guerres ne vont pas empêcher la mise en place d’une exploitation qui tourne au pillage. Les impôts de diverses natures habituellement payés à L’Inca sont alourdis, leurs conditions sont durcies, et surtout ils ne donnent plus droit à aucune contrepartie aux contributeurs. (Un exemple : les Incas prélevaient des tributs en produits tissés, mais ils fournissaient les fibres. Sous le règne des Espagnols les indiens doivent fournir le travail de tissage en plus des fibres). Différents types de servitude existaient avant les Espagnols, mais pour un grand nombre d’indiens la servitude ressemble de plus en plus à de l’esclavage (théoriquement interdit). La désorganisation de l’appareil productif est complète, alors que les nouveaux maîtres ont des exigences croissantes. Il en résulte famines, violences, suicides, ou fuites vers des régions échappant à leur contrôle. Comme les Incas pratiquaient depuis longtemps la déportation collective de populations pour diviser leurs vassaux et coloniser certaines régions moins peuplées, ces groupes de « mitimaes » tentent de retourner dans leurs régions d’origine. Parmi les nombreuses données que fournit Nathan Wachtel sur ce « nouvel ordre » imposé par les espagnols, certaines sont assez surprenantes. Par exemple l’augmentation très forte de la culture de la coca qui sert de stimulant aux indiens forcés de travailler dans les mines ou autres chantiers. Même si à cette époque on ne sait pas extraire la cocaïne de la feuille, on peut se demander si ce n’est pas là l’origine de cette économie toxique qui gangrène le continent jusqu’à nos jours. Même si les missionnaires catholiques dans un premier temps s’opposent à cette plante « diabolique » car associée à l’ancienne religion indigène, ils finissent par comprendre où est leur intérêt économique. Autre exemple, le développement du servage sous couvert d’évangélisation : les Espagnols se partagent les populations et les fiefs. Les indiens en échange de la « vraie religion » doivent travailler pour les seigneurs à qui ils sont « confiés », c’est la pratique de l’encomienda. Autre détail surprenant : certains Noirs libres arrivés avec les Espagnols peuvent être autorisés eux aussi à « posséder » des indiens. Il est à noter que dès l’époque de Christophe Colomb et tout au long de l’époque coloniale, les successifs rois d’Espagne ne cessent d’édicter des législations interdisant l’esclavage et les mauvais traitements contre les indiens, autant de lois qui restent lettre morte. L’Espagne est loin et les colons n’en font qu’à leur tête. Madrid ferme les yeux tant que les métaux précieux arrivent. La classe des « yanaconas » qui étaient des serviteurs à l’époque pré-hispanique devient de plus en plus nombreuse, car ne possédant pas de terres elle est exemptée d’impôt. De nombreux indiens préfèrent se déclarer « yanaconas » au service d’un maître plutôt que paysans « libres » appartenant à une communauté « ayllu » et donc sujets à l’impôt. C’est un exemple de la manière dont le nouvel ordre bouleverse les structures de la société et déracine des populations jusqu’alors très agricoles. L’imposition du catholicisme et la lutte contre les anciennes religions est un autre facteur de déstructuration de la société.
Face à ces bouleversements différents mécanismes d’adaptation et d’acculturation se mettent en place. Les empires coloniaux depuis l’Antiquité ont été d’énormes machines à produire de l’acculturation. Au Pérou même avant l’arrivée des Espagnols, les Incas étaient devenus minoritaires dans leur empire, dont une bonne partie de la population était constituée de « déplacés » ou « déportés » par l’autorité de l’état. (Près d’un quart selon certains auteurs). Les mariages princiers servaient à confirmer les allégeances et il en résultait un métissage dans l’aristocratie, comme ce fut le cas pour Atahualpa, d’où la réticence de certains à l’accepter comme empereur. L’arrivée des Espagnols va prolonger et intensifier ces phénomènes. Les soudards de Pizarre épousent des princesses incas (bon gré, mal gré, mais cela n’est pas propre au système colonial, car les princesses ont toujours et partout été de la chair à mariage politique, ce qui n’est pas pire qu’être sacrifié en chair à canon comme un mâle des catégories sociales inférieures), ce qui est l’origine d’une aristocratie métisse hispanisée et christianisée, dont l’exemple le plus connu est Inca Garcilaso de la Vega, qui finira ses jours à Cordoue. (Il meurt le même jour que Cervantes). Cette aristocratie mixte se prolonge au moins jusqu’au dix-neuvième siècle, où elle est encore incarnée par Dionisio Inca Yupanqui, député aux Cortes de Cadix en 1810, à l’époque de l’invasion de l’Espagne par Napoléon. (Mais Tupac Amaru II, le chef de la dernière grande révolte inca au XVIII° est lui aussi issu de cette aristocratie hispanisée). Bien entendu tous les métis n’ont pas le « privilège » de naître dans l’aristocratie. Un bon nombre se retrouvent dans une situation de rejet par les deux communautés, il leur reste la carrière militaire : ils seront nombreux à participer aux expéditions contre les indigènes du Chili.
La conversion, forcée, au catholicisme est une autre acculturation, même si elle n’empêche pas une certaine duplicité des convertis qui conservent parallèlement leurs anciennes croyances, ce que Nathan Wachtel étudie en détail. Il analyse notamment la différence d’attitude entre les deux fameux chroniqueurs, Garcilaso de la Vega, le métis, qui arrive à concilier les deux cultures, et Guamàn Poma de Ayala, pur indien qui, bien que converti au catholicisme et à la langue espagnole, reste plus attaché à la tradition indigène.
Les habitudes vestimentaires et alimentaires changent aussi sous l’influence espagnole, et l’usage de la feuille de coca se généralise selon Wachtel, pour les raisons déjà vues plus haut.
L’adoption du cheval (introduit par les Espagnols) est sans doute un des plus grands bouleversements pour les indiens qui, soit par des vols, soit par des captures d’animaux échappés, vont très vite se transformer en peuples cavaliers experts. Ce phénomène se produit surtout aux marges nord de la conquête au Mexique, et aux marges sud du côté du Chili et de l’Argentine. La maîtrise du cheval permettra à ceux qui l’ont acquise de résister beaucoup plus longtemps aux envahisseurs européens. (Chichimèques, Apaches,au nord, Araucans, Mapuches au sud…) Ces peuples n’étant pas organisés en états centralisés sont moins vulnérables aux tactiques employées par les Espagnols contre les Aztèques et les Incas.
La fin de l’étude de Nathan Wachtel est d’ailleurs consacrée aux longues années de résistance et de révoltes des indiens, de la part du royaume inca de Vilcabamba au début, jusqu’à Tupac Amaru II au XVIII° siècle. Mais les plus fortes résistances viendront de peuples marginaux qui n’était pas complètement, voire pas du tout, soumis aux Incas. C’est là le sujet étudié en profondeur dans le livre suivant.
« L’Inca, l’Espagnol et les Sauvages » est encore un de ces livres qui étaient dans ma bibliothèque depuis l’époque de sa publication en 1986. C’est un pavé de 400 pages au format A4 qui en vaudraient près de 800 au format d’un livre habituel. Parmi les trois auteurs, Anne-Christine Taylor-Descola est l’épouse de Philippe Descola, avec qui elle a vécu en Amazonie équatorienne à la fin des années 70 ou au début des années 80. J’ai eu l’occasion de les rencontrer quelques fois car ils étaient amis de mes parents, à l’époque où nous vivions aussi en Equateur. Disciples de Lévi-Strauss, ils vivaient alors chez les Shuars d’Equateur, près de la frontière péruvienne. Philippe Descola a d’ailleurs publié le récit de cette expérience dans la fameuse collection « Terre Humaine », sous le titre « Les lances du crépuscule », que j’ai lu peu après sa parution. Philippe Descola est le fils de Jean Descola, hispaniste dont j’avais lu les classiques : « Les Conquistadors » et « Les Libertadors ». Autant dire que cette famille a pesé lourd dans mes apprentissages.
Le propos de « L’Inca, l’Espagnol et les Sauvages » est particulièrement intéressant : il s’agit d’abolir la barrière entre histoire et anthropologie, qui séparait d’une part les civilisés Incas, avec leur état administré, leurs villes, leur monarchie, leurs armées organisées, leur histoire, et d’autre part les « sauvages » habitants des versants amazoniens des Andes, supposément figés dans une identité préhistorique, hors du temps, exclus de l’histoire. Il s’agit de montrer que bien au contraire les peuples montagnards et forestiers ont évolué depuis des milliers d’années en interactions constantes, parfois pacifiques, parfois violentes.
La première partie du livre est signée par deux chercheurs français, France-Marie Renard-Casevitz, et Thierry Saignes, et porte sur les territoires Incas correspondant actuellement au Pérou et à la Bolivie. L’étude plonge loin dans le passé, se référant aux recherches d’archéologues péruviens dont le plus connu est Luis Lumbreras. Les fouilles démontrent que depuis des milliers d’années ont existé des échanges de produits végétaux, de coquillages, d’objets, entre les trois principales zones géographiques des pays andins : côte pacifique, montagne et forêt amazonienne. Puis se développent des cultures qui vont créer des villes, et les premiers états de la région : Caral, Chavìn, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Wari (ou Huari)… L’état huari est déjà décrit comme théocratique, impérialiste et militaire (sans aucune influence européenne, comme c’est étrange) et dure du VII° au XIII° siècle selon notre calendrier. L’état Inca se développe au premier tiers du XV° siècle et va connaître un développement foudroyant, car il atteint son développement maximal cent ans plus tard, juste avant l’arrivée des Espagnols. La ville de Cuzco est sa capitale politique et religieuse, et l’empire (Tawantinsuyu) se divise en quatre quarts symboliques autour d’elle, selon les 4 points cardinaux : Chinchaysuyu (nord-ouest), Cuntisuyu (sud-ouest), Collasuyu (sud-est) et Antisuyu (nord-est). Les deux derniers secteurs sont ceux qui possèdent des frontières avec les « sauvages » des versants amazoniens de la cordillère andine. Le nom même des Andes dérive de celui d’un de ces peuples que les incas appelaient « Anti ».
Les auteurs de « L’Inca, l’Espagnol et les Sauvages » évoquent la capacité de l’empire à lever une armée de 40 000 hommes pour partir à la conquête du nord, territoires appartenant actuellement à l’Equateur. D’autres sources vont jusqu’à 200 000, divisées en armées de 10 000. Cela dépend sans doute de l’époque. Ce qui est certain c’est qu’à mesure que ces armées se développent, elles intègrent de plus en plus d’ethnies vassalisées, les Incas devenant minoritaires et occupant les postes de commandement. À titre de comparaison, une légion romaine comptait environ 4000 hommes : Rome a levé jusqu’à 60 légions, soit 240 000, ont est dans le même ordre de grandeur que les Incas. Rome avait une mer au milieu de son empire, était-ce plus avantageux que des chaînes de montagnes de 5000 mètres et plus ? Difficile de spéculer là-dessus.
L’extension territoriale de l’empire Inca culmine à environ 1 800 000 km2, à comparer à l’empire du Mali, environ 1 300 000 km2, ou l’empire romain, près de 5 000 000 km2 à son apogée. Le plus grand des empires pré-modernes étant l’empire Mongol avec 24 000 000 km2. Des comparaisons à nuancer en fonction des structures politiques, des densités de population, des conditions naturelles…
Mais revenons à nos « sauvages » et leurs relations avec les Incas. Sur des milliers de kilomètres de frontières c’est une grande diversité de tribus ou d’ethnies, appartenant surtout aux familles arawak et tupi-guarani qui peuplent les forêts équatoriales humides du piémont andin. D’autres groupes comme les fameux « Anti » peuvent servir d’intermédiaires avec les habitants des hauts plateaux. C’est donc une mosaïque complexe de peuples avec leurs interactions qui peuvent varier selon les moments. La forêt est un milieu hostile pour les montagnards, et les armées des Incas ne sont pas en mesure de s’imposer aux insaisissables habitants de ces jungles.
Montesinos, chroniqueur espagnol ayant visité le Pérou cent ans après la conquête espagnole et recueilli des informations sur l’histoire des Incas rapporte qu’avant son expansion impériale le royaume de Cuzco a été victime de plusieurs invasions menées par les « Anti » et d’autres peuples des forêts. (Comment ne pas penser à la prise de Rome par les Gaulois ?) De ces mésaventures les Incas conservent une image très négative des « sauvages », décrits comme anarchiques, bestiaux, sodomites et cannibales. Ce qui n’empêchera pas les échanges à certains moments. À chaque empire ses « barbares » et ses préjugés racistes, en Europe comme ailleurs.
Une des difficultés sur lesquelles ont buté les auteurs a été d’identifier avec précision les groupes ethniques et les lieux géographiques évoqués par les anciennes chroniques, dont les auteurs n’avait pas toujours des connaissances très précises. Une grande partie du livre est consacrée à recenser pour chaque secteur de la frontière, les faits, les lieux, les dates…
Il apparaît que malgré les affrontements, les gens des montagnes et ceux des forêts avaient besoin les uns des autres. Les produits de la forêts, végétaux, or des rivières, et plumes d’oiseaux pour les parures étaient très recherchés par les Incas. En retour les « sauvages » étaient demandeurs d’outils en métal. Mais il y a aussi des échanges culturels, les chamanes de la forêt étant réputés, leurs homologues Incas se rendaient parfois chez eux pour partager des connaissances. (Les hippies d’aujourd’hui qui vont se défoncer à l’ayahuasca au Pérou ne font donc rien de nouveau.) Chose intéressante, quand les conquistadors espagnols se substituent à l’autorité des Incas, les « sauvages » résistent par les armes, mais restent ouverts à la venue de missionnaires catholiques, comme une continuité de leurs relations avec les prêtres Incas. (On imagine d’ici la découverte de l’ayahuasca par un franciscain du XVI° siècle !). À ce propos le livre rapporte une croyance de certains « sauvages » selon laquelle les Espagnols étaient des démons surgis de terre par la faute des Incas qui creusaient le sol pour trouver de l’or. Mais ces démons pouvaient être humanisés en leur faisant manger du manioc doux, aliment de base des « sauvages ».
Les Incas avaient besoin de contrôler des territoires à moyenne altitude pour la culture de la coca, et par la suite les espagnols, on l’a vu, vont développer cette culture, raison pour laquelle l’empire poussait partout où il le pouvait son emprise aux confins des territoires «sauvages». Les Incas utilisèrent souvent les mitimaes (des peuples vassalisés et déportés d’autorité) pour coloniser ces régions. Les Espagnols en feront autant à leur tour y compris avec des milliers d’Indiens du Nicaragua, enrôlés de force dans leurs armées pour finir la conquête de l’empire Inca, puis installés comme colons. (Encore une fois on pense aux méthodes de l’empire romain, avec ses légionnaires-colons, ou ses peuples fédérés au long des limes.)
Parmi les autres faits historiques méconnus découverts à la lecture de ce livre je note ce cas extrêmement intéressant en 1603, celui d’une révolte d’indiens « sauvages » et d’esclaves noirs marrons menée conjointement contre les Espagnols par des chefs dont voici les noms : l’amazonien Francisco Chichima, le Guaraní Kunumi, les Noirs Juan Bañón et Domingo Biafra.
Dans le quadrant sud-est de l’empire, sur les piémonts donnant du côté des états actuels du Paraguay et de l’Argentine (région du Chaco) les Incas se heurtent à des peuples de la famille linguistique tupi-guarani, dont les plus redoutables sont les Chiriguanos. Des mouvements de migrations guarani mettent la pression sur cette frontière au cœur du continent (on pense à un Giovanni Drogo de l’armée inca). C’est à l’occasion d’un de ces raids guaranis que le Portugais Alejo Garcia est le premier Européen à entrer dans l’empire Inca en provenance de la côte sud du Brésil, dix ans avant Pizarro, mais sans succès car il sera tué par ses « associés » guaranis. Plus tard, sous la domination espagnole, les Chiriguanos tiennent tête aux colonisateurs, mais sont aussi leurs fournisseurs d’esclaves indiens razziés chez d’autres ethnies.
Bien : la somme d’informations apportée par les 200 premières pages de « L’Inca, l’Espagnol et les Sauvages » est énorme et ne peut être résumée ici, mais elle arrive à une conclusion très intéressante : jusqu’au XVIII° siècle les Espagnols, bien que se substituant aux Incas dans le contrôle de l’empire, seront incapables de vaincre les « sauvages » et même ils devront reculer de 100 à 200 kilomètres sur certaines parties des frontières orientales et australes du « Tawantinsuyu ». Ce n’est qu’au dix-neuvième siècle que les républiques sud-américaines devenues indépendantes mèneront les politiques (plus ou moins génocidaires) nécessaires au contrôle complet de leurs territoires. (Les actuels conflits entre populations indigènes et géants du soja, multinationales du bois, ou compagnies minières et pétrolières, jusqu’à la mise en accusation de Bolsonaro pour génocide en sont la continuité directe : on peut légitimement se demander si la politique du président brésilien sur le covid ne vise pas implicitement à achever l’élimination de populations amazoniennes gênantes. La pandémie comme une aubaine.)
La deuxième partie du livre est celle que signe Anne-Christine Taylor-Descola, et elle embrasse une région plus petite de cette frontière, à l’histoire différente, car elle concerne le territoire de l’actuel Equateur, c’est-à-dire à l’extrémité nord de l’empire des Incas, qu’ils contrôlaient depuis peu lorsque les Espagnols apparurent. Son approche est la même que dans la première partie : elle envisage les « sauvages » comme acteurs à part entière de l’histoire, en relation avec les Incas, puis les Espagnols.
La région étudiée est le piémont du sud-est équatorien, aux confins du Pérou actuel. Elle se distingue d’autres parties de l’empire Inca par l’absence de transition entre montagne (sierra) et forêt dense (montaña) tant les pentes sont escarpées et entaillées de vallées encaissées, avec plusieurs volcans très actifs. Cette géographie très difficile a servi de prétexte à une indétermination des frontières qui motiva plusieurs guerres entre les deux pays jusqu’à la fin du XX° siècle. À plus forte raison les récits des premiers espagnols ayant parcouru la région dès le XVI° sont entachés d’imprécisions qui obligent la chercheuse à de nombreux recoupements et vérifications.
Humainement aussi cette région se différencie car sa partie montagnarde était peuplée surtout par les Cañar, un peuple qui avait fortement résisté à l’impérialisme Inca et fut un des premiers à se rallier aux Espagnols, avant même la capture d’Atahualpa par Pizarro. D’autre part il semble qu’il n’y avait pas toujours de franche opposition entre peuples de la forêt et peuples de la sierra, car ils étaient très proches, la majorité des Cañar avaient un mode de vie montagnard (élevage de lamas, de cochons d’inde, culture de la pomme de terre…) quand d’autres étaient adaptés à la vie en forêt tropicale (chasse, pêche, maraichage en sous-bois…) tout en appartenant à la même ethnie. Mais d’autres populations qui occupaient les basses-terres étaient plus typiquement amazoniennes.
Malheureusement, tous ces puissants torrents dévalant des Andes volcaniques vers l’Amazone étaient riches en or. (Et plus bas, pour comble de leur malheur, il y avait du pétrole, mais cela ne fut connu qu’au XX° siècle.)
Revenons à nos « sauvages ». Anne-Christine Taylor-Descola s’est livrée à une analyse approfondie des récits d’expéditions espagnoles dans cette région, pour essayer d’en reconstituer l’aspect géographique et surtout humain à cette époque. Les conquistadores n’avaient pas été à l’école de Lévi Strauss, ce qui oblige l’auteur à de nombreuses vérifications pour comprendre les dramatiques destructions et recompositions ethniques ayant conduit à la situation actuelle. N’oublions pas qu’il s’agit de sortir les « sauvages » du cliché d’une identité figée depuis la préhistoire, dans un « état de nature » qui n’a jamais existé, et pour cela reconstituer l’histoire des bouleversements qui les ont affectés depuis plusieurs siècles. (Pour ma part chaque fois que je pense aux Indiens d’Amazonie, je me souviens que leurs ancêtres ont vécu en Sibérie, en Alaska, et puis où, dans les grandes plaines d’Amérique du nord peut être, ou bien aux Antilles, ou au Panama ? Et je m’abstiendrai de remonter en Afrique jusqu’à Lucy ou Toumaï.)
Ce qui frappe dans cette étude d’Anne-Christine Taylor-Descola, c’est la rapidité avec laquelle les Espagnols, pourtant très peu nombreux, arrivent à se répandre sur ces immenses territoires. Sans l’appui massif de certains indigènes cela aurait été impossible. Même si par la suite certains se sont révoltés contre la brutalité et la cupidité des Espagnols, mettant fin aux alliances.
L’histoire de cette région est marquée par trois phénomènes : une ruée vers l’or accompagnée de razzias esclavagistes, les tentatives d’installations de missions catholiques et les épidémies qui en découlent. Cela va aboutir à une destruction du tissus ethnique et sa recomposition par les rares survivants. Les « mines d’or » ne sont pas des galeries creusées sous terre, mais des gisements fluviaux en forêt, exploités par l’orpaillage, ce qui nécessite beaucoup de main d’œuvre servile. La mortalité par épidémies et abus est très élevée chez les esclaves qu’il faut constamment renouveler en attaquant les villages dispersés dans la jungle, avec l’aide de guides et guerriers indigènes. Le bilan des razzias se compte en « pièces » capturées.
À cette époque les Espagnols fondent pas moins de huit « villes » dans la forêt, sous des noms aussi pompeux que « Sevilla del Oro », mais en fait de villes c’était sans doute des campements dans la jungle, ou des villes-champignons de chercheurs d’or dont il ne reste presque rien aujourd’hui, car les nombreuses attaques d’indiens ont fini par en chasser les habitants.
D’autre part les missionnaires tentent d’installer des « réductions » au bord des fleuves, les indiens convertis et vivant avec les missionnaires devant en principe être épargnés par les razzias esclavagistes. Mais les missions sont aussi des foyers de contamination, et les abus de certains missionnaires aboutissent parfois à des révoltes : les indiens tuent l’Espagnol, brûlent la mission et retournent en forêt.
À la longue les Espagnols devront se retirer de cette région trop hostile, après y avoir causé beaucoup de dégâts, abandonnant leurs huit « villes », et ils n’y reviendront que très progressivement dans les siècles suivants. Là encore c’est la république indépendante qui finira le « travail » de soumission ou d’élimination des Indiens, surtout après la découverte du pétrole.
Toutes les histoires rapportées par ce livre pourraient servir de sources à un grand nombre de livres ou de films. Bien sûr il y a déjà eu «Mission» mais cela concernait une toute autre région, à des milliers de kilomètres de là, aux confins de l’Argentine et du Paraguay.
À mesure que j’avançais dans la lecture de « La vision des vaincus » puis de « L’Inca, l’Espagnol et les Sauvages », j’ai ressenti le besoin de lire un livre péruvien non pas sur la chute, mais sur l’ascension de l’empire Inca. Une rapide recherche m’a fait connaître l’historienne Marìa Rostworowski, et j’ai pu me procurer rapidement son livre dont je parlerai dans la deuxième partie de cet article.
À SUIVRE




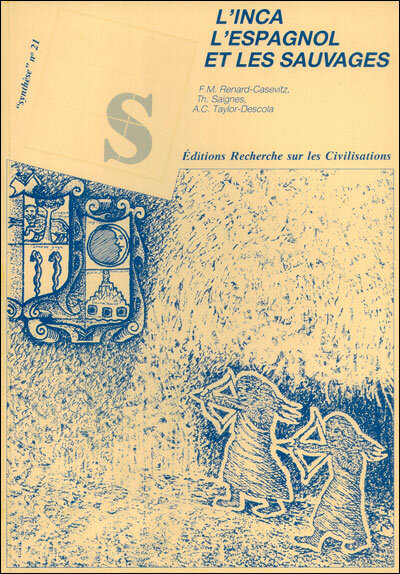


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F70%2F1659927%2F132161344_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F34%2F1659927%2F131556166_o.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F74%2F51%2F1659927%2F130526073_o.jpeg)
/http%3A%2F%2Fwww.monde-diplomatique.fr%2FIMG%2Fjpg%2Fcia-2.jpg)