2020 : 20 décembre : La préface de "L'Auto", de Carlos Rehermann.
Carlos Rehermann. (Photo de Celeste Carnevale)
En avant-première de la sortie du roman "El Auto" de Carlos Rehermann, que j'ai traduit, en voici la préface. C'est seulement la deuxième fois que je me livre à cet exercice...
Les tribulations d’Alejo Murillo en Uruguay.
Il existe une ancienne parenté entre la littérature française et la littérature uruguayenne, qui s’incarne notamment dans trois figures tutélaires : Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, le plus connu sans doute, Jules Laforgue, et Jules Supervielle. Trois franco-uruguayens qui écrivaient en français et dont, chez nous, on oublierait parfois la facette sud-américaine. Jusqu’aux années 1970 la grande majorité de l’intelligentsia uruguayenne est francophone et francophile, et par la suite, même si l’usage de notre langue tend à se perdre, l’influence de nos « grands penseurs » (parfois surestimés) reste importante, grâce aux traductions. Dans la génération née au tournant des années 1960 (et plus tard), ils ne sont plus très nombreux à maîtriser parfaitement notre langue aujourd’hui. Les responsables de cette décadence sont à chercher à Paris.
Carlos Rehermann, né à Montevideo en 1961, est l’un des rares écrivains uruguayens actuels encore parfaitement francophones, même s’il écrit en espagnol. Enfant d’une famille modeste, il fait partie de la génération dont l’adolescence et la jeunesse furent saccagées par la dictature civico-militaire, officiellement de 1973 à 1984, même si les temps difficiles commencèrent plus tôt et se prolongèrent au-delà.
Aux temps de la dictature, l’Alliance française et la Cinémathèque de Montevideo furent deux des bastions de la résistance culturelle. C’est dans ce milieu que le jeune Rehermann fait ses premières universités, un milieu souvent élitiste où ses origines sociales font tache. Ce malaise à se situer socialement, cette impression de n’être vraiment ni d’une classe ni de l’autre, et d’être doublement rejeté, est un des traits de caractère d’Alejo Murillo, protagoniste principal de L’Auto. Murillo apparaît dans d’autres romans de Rehermann, jusqu’à un certain point, comme un alter ego de l’auteur. Ils ont en commun une immense culture cinématographique, que l’on trouve aussi dans L’Auto, notamment avec les références au film d’Alain Corneau, « La Menace » (1977). Nul doute, sans même l’avoir mis à l’épreuve, que Rehermann soit incollable sur tout le cinéma français des années 70, et bien plus.
Outre l’Alliance française et la Cinémathèque, c’est dans une piscine publique que le jeune Rehermann s’est formé en se découvrant une autre passion, la plongée en apnée. C’est là un des fils conducteurs de son roman Tesoro, hommage à son père, dans lequel il évoque aussi ses rêves de trésors engloutis, avec le navire « Nuestra Senora de la Luz », dans les eaux couleur café du Rio de la Plata. Comme bien des jeunes de sa génération tout autour de la planète, il rêva des aventures de Cousteau et de Robert Sténuit.
Ce père, Aquiles, semble se confondre avec celui d’Alejo Murillo dans L’Auto, qui porte le même prénom. Dans les deux romans le père, malgré sa pauvreté, a su habilement faire pression sur la direction corrompue d’un collège catholique pour que son fils puisse bénéficier de la meilleure éducation accessible en ces années où la dictature poussait chacun à cultiver le pire de lui-même. Aquiles, ce héros, indifférent à l’argent et au pouvoir, toujours capable d’obtenir le meilleur pour son enfant, vivant selon sa propre morale, nous rappelle certains personnages d’Albert Cossery. Les premières phrases de « Tesoro » pourraient sans doute définir le legs philosophique d’Aquiles à son fils, un sens du tragique et de l’absurde de l’existence qui traverse toute l’œuvre de Carlos Rehermann :
« Ce qui arrive c’est qu’un jour, peut-être brutalement, mais plus probablement d’une manière lente et discrète, il devient évident que rien n’a de sens. (…) Rien ne fonctionne bien ou mal ; cela nous devrions le savoir, puisque tout se dirige inexorablement vers le néant. Après avoir beaucoup pensé, donné de la valeur à la réflexion, à l’élaboration d’idées, à l’effort de se cultiver soi-même, on finit par se rendre compte que le plus marginal des déclassés, ou l’hédoniste le plus radical, ont le même sens que soi-même : aucun ».
Après des études embrassant ingénierie, architecture et sciences humaines, Rehermann s’est tourné vers le théâtre et l’écriture, ayant sans doute hérité de son père un certain dédain de l’argent quand celui-ci corrompt, comme cela peut-être le cas dans l’industrie de la construction.
C’est un autre héritage, bien plus matériel, qui ramène Alejo Murillo des années plus tard, dans la région d’origine de sa famille, à Rivera, ville-frontière avec le Brésil, après la mort d’un beau-frère d’Aquiles, vieux grippe-sou. L’essentiel de cet héritage est une Volkswagen Coccinelle de 1962, c’est l’auto dans laquelle Alejo va effectuer sa traversée de l’Uruguay par la route numéro 5, tout seul, de nuit, sous l’orage, avec des essuie-glaces en panne. Circonstances idéales pour les divagations mentales et les rencontres bizarres.
Il ne faut pas compter sur Rehermann pour nous décrire les paysages enchanteurs de l’Uruguay profond, ou son folklore, bien au contraire, le folklore en prend ici pour son grade, avec une scène homérique où les gauchos et leurs montures dérapent et se vautrent dans un torrent de merde et d’urine.
Le voyage sera beaucoup plus intérieur que pittoresque : Alejo Murillo est un jeune écrivain dont l’esprit fait le cheval échappé. Même si le livre est court, il donne place à de nombreuses digressions (ce n’est pas en vain que Tristram Shandy est cité en exergue), sur l’écriture, le cinéma, ou les complexes de ce jeune homme qui a du mal à gérer ses relations sociales, se sentant souvent en porte-à-faux, tant avec les plus riches, qu’avec les plus pauvres.
Au début, il ne résiste pas à la tentation de faire un crochet par le village de Tranqueras, berceau de la famille. Arrivant au crépuscule il découvre l’endroit étrangement calme et désert, alors que pour le lecteur c’est l’occasion de découvrir quelques anecdotes scabreuses de l’histoire familiale, certaines ignorées même d’Alejo qui traverse au pas ce village fantôme comme si ses ancêtres le regardaient passer, cachés derrière leurs persiennes.
Avec la nuit et l’orage, une simple panne d’essuie-glace, et des rencontres de hasard, de station-service en hôtel borgne, feront basculer le voyage dans l’imprévu. Après des chapitres correspondant à des tronçons du parcours, chacun avec son kilométrage, surgit une deuxième histoire dans l’histoire, celle d’un sabbat dans une luxueuse estancia perdue dans la nuit et le campo (la campagne de l’Uruguay), comme une parenthèse de magie et d’érotisme, ce qui n’est pas sans évoquer un célèbre roman à tiroirs, cher à Rehermann, le Manuscrit trouvé à Saragosse, de Jan Potocki. (Et là encore, ce n’est pas en vain que l’on trouve, en exergue de L’Auto, une citation du Zohar, le livre cabaliste judéo-espagnol.)
Au matin, Alejo Murillo retrouvera sa réalité prosaïque, ses kilomètres à parcourir, et ses complexes sociaux, dans un ultime épisode qui ne tourne pas vraiment à sa gloire, pour une fin de voyage qui n’en est pas vraiment une.
Pour une première traduction d’un roman de Carlos Rehermann en français, L’Auto présentait l’intérêt d’offrir des ouvertures vers le reste de l’œuvre de cet auteur, qui a déjà publié en Uruguay depuis les années 1990 un bon nombre de romans et d’œuvres théâtrales, dont certaines en collaboration avec sa compagne, Sandra Massera, elle aussi auteur et metteur en scène. Ce travail théâtral leur a permis de se produire dans divers festivals en Argentine, au Brésil, et en France.
Il n’est pas possible ici d’être exhaustif sur cette œuvre encore en construction (Rehermann continue à écrire et publier) : aussi, ayant déjà évoqué « Tesoro », il semble important d’attirer l’attention du lecteur curieux sur ce qui reste sans doute à ce jour l’œuvre majeure de Rehermann, encore à traduire, le roman « Dodecamerón », paru en 2008. Derrière ce clin d’œil a Boccace, il y a 144 récits, douze fois douze histoires que se racontent les passagers d’un yacht à la dérive en attendant les secours. L’un de ces passagers-conteurs, et le principal narrateur et compilateur du livre n’est autre qu’Alejo Murillo, toujours lui.
Le critique Ramiro Sanchiz a écrit que le Dodecamerón était le meilleur roman uruguayen du début du XXIème siècle. Il s’agit d’un livre très ambitieux, dans lequel Carlos Rehermann laisse s’exprimer toutes ses admirations littéraires, et toute son érudition. On a vu la grande connaissance qu’il a de la culture française des années 70, on comprendra sa passion pour Georges Perec et « La vie, mode d’emploi ». Après Boccace, Potocki et Perec, notamment, Rehermann a construit un de ces livres aux multiples facettes et tiroirs, dans lesquels de nombreuses histoires se répondent, formant un réseau, une architecture aux multiples entrées, qu’un index aide à retrouver. On n’y trouvera pourtant aucune pédanterie, bien au contraire, l’ironie comme l’humour potache, l’érotisme et un doigt de scatologie y ont toute leur place.
L’écrivain Ercole Lissardi considérait le « Dodecamerón » comme « …un livre unique qui dès sa parution exige une place parmi les meilleurs de notre littérature ». On ajoutera que cette construction ludique, qui tient à la fois du roman à tiroirs et du cadavre exquis, ne manque pas de faire penser à la tradition gauchesque de la payada. Ce duel d’improvisation virtuose en vers, demande une grande capacité de répartie (repentismo), comme en font preuve, avec humour, les divers narrateurs du Dodecamerón. On a vu comment, dans L’Auto, Rehermann se moque du folklorisme gaucho qui tourne souvent à la foire identitaire. Malgré tout, il sait aussi reconnaître le meilleur de cette culture.
Avant de publier L’Auto, les éditions Latinoir ont déjà ouvert la voie à la traduction des œuvres de Carlos Rehermann en France avec son texte « Vaudou » dans l’anthologie bilingue « Nouvelles histoires d’Uruguay ». Cette anthologie présente l’intérêt de situer l’auteur dans son entourage générationnel, aux côtés d’Amir Hamed (1962-2017) et Gustavo Espinosa (1961), non loin d’autres écrivains à peine plus âgés comme Rafael Courtoisie, Ana Solari, Hugo Fontana, Jorge Chagas, Mercedes Rosende, Marcia Collazo, Andrea Blanqué. Dans cette liste c’est Amir Hamed, décédé prématurément, qui faisait figure de pivot parmi ceux de son âge, catalyseur d’amitiés littéraires et musicales autour d’un orchestre de blues et d’une maison d’édition.
Voilà donc cher lecteur, chère lectrice, vers quelle œuvre vous vous dirigez en montant dans cette Volkswagen Coccinelle de 1962.
Antoine Barral



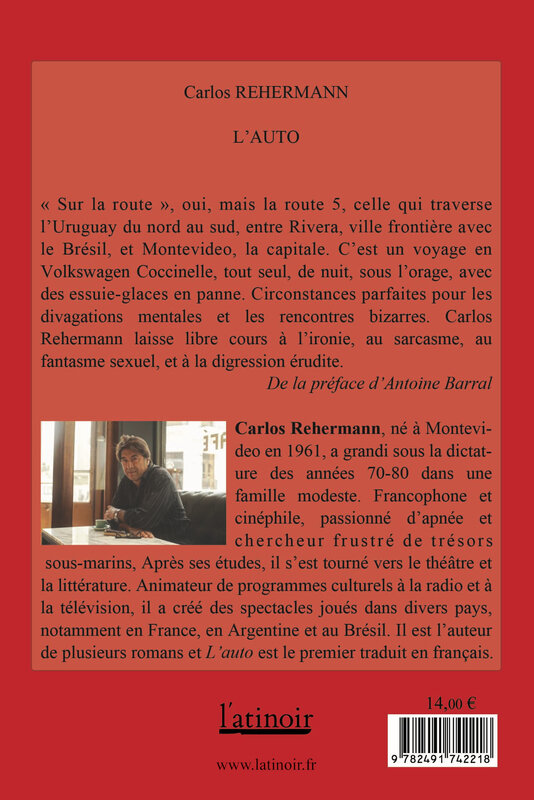


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F76%2F1659927%2F133360796_o.jpeg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F00%2F68%2F1659927%2F132541395_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F12%2F39%2F1659927%2F128984465_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F33%2F1659927%2F127296692_o.jpg)